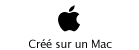films 1978/81

à propos de l’homme rouge...
(...) mon énergie participe à un mouvement qui dépasse l’humain : ce mouvement de construction et de déconstruction est celui-là même de la vie. Par «un mouvement qui dépasse l’humain», je ne définis pas Dieu. Je ne crois pas en un dieu d’avant la Matière. Je crois en la matière comme mère de la vie et en l’esprit comme prince des cieux. Je suis les deux et je refuse de m’amputer. Je ne supporterais pas d’avoir une puissance au-dessus de moi qui ne soit pas moi. Je n’ai pas à détrôner cette puissance supérieure: je suis cette puissance. (...) T.C (septembre 1979)
Je sens que je suis sujet à des forces que je ne contrôle pas. L’homme rouge est venu directement s’inscrire en images dans ma pensée. Une violence extraordinaire qui demandait à s’exprimer. Je le voyais alors muni d’une hache et fracassant tout sur son passage. Avec le temps, je renonçais à trouver quoi fracasser. La violence était sans objet sur lequel s’assouvir. J’étais à la fois l’objet et le sujet de cette violence.
T.C (décembre 1979)
à propos de Pièce grise...
Cette action-vidéo trouvera un écho dans des réalisations ultérieures ; "L'homme rouge", "Spirale", "Chien-ibis" et plus particulièrement dans "Rouge, jaune, bleu".
Cet écho est celui de l'INCARNATION. Les personnages de ce repas transgressent la nature. Il existe un accouplement monstrueux entre, d'une part un monde réel représenté par une fonction organique, et d'autre part un monde symbolique , représenté par une répartition irréelle des couleurs (nourritures aux couleurs saturées, personnages gris...)
(...) Cette scène n'est pas sans rappeler les cérémonie d'anthropophagie. Comme dans dans le phénomène de capillarité, chacun des corps réunis autour de cette table deviendra monochrome, incarnant la couleur qu'il vient d'absorber. Multiples rapports avec la cène.
Pièce blanche et l’homme rouge
Dans Pièce blanche, redondance dans le sens d’une création d’un espace de création (le parc). Le personnage est à la fois le démiurge (on dirait qu’il «crée» l’espace du parc, qu’il lui donne âme par diverses manipulations) et l’objet créé par le parc (il sort du parc comme d’un espace matriciel). L’ensemble de la cérémonie a quelque chose de virginal, d’une naissance. C’est la première vidéo que je réalise. Il y a une double naissance: naissance d’un espace sacré (la pièce blanche est ici symbolisée par la redondance du parc vide) et la naissance de moimême au sacré (thème repris dans les vidéos suivantes, L’accouchement et Dédoublement ). Le rapprochement des titres de la première vidéo Pièce blanche et de la sixième vidéo L’homme rouge me semble évocateur: l’accent est mis sur l’espace dans la première, dans l’autre en revanche c’est du corps dont il est question. Elles sont étrangement liées. Dans L’homme rouge, le parc a disparu, nul objet n’est possible, le contact avec l’energie est direct. Le corps est écorché, directement en contact avec l’espace. «L’énergie est la seule vie, et elle est du corps, et la raison est la limite ou la circonférence qui entoure l’énergie.» (William Blake, Le mariage du ciel et de l’enfer) La structure de l’espace dans Pièce blanche est en anneau, c’est-à-dire avec constamment ce trou de vide centre qui appelle à lui toutes les énergies du cosmos. Le corps circule dans l’anneau, entre deux vides, l’intérieur et l’extérieur. Puis il pénètre le centre. Très proche d’Astérios, renaissance initiatique du «regressum ad uterum». Enfin il ressort de ce centre et retourne dans l’anneau tout en allant se coller à sa paroi extérieure, vers le vide extérieur de l’anneau. L’homme rouge au contraire est un cercle et on y sent l’absence de protection. La chair est à vif. L’homme se projette sur les parois de l’espace comme pour disparaître dans le vide ou vient frapper le sol de l’espace comme s’il y cherchait un centre absent, la possibilité d’un vide intérieur à l’espace. C’est la matière pleine et douloureuse, chargée d’une énergie centripète et centrifuge.Mais il me semble que cette vidéo se devait de suivre Pièce blanche, qu’elle en est en quelque sorte le complément nécessaire. La première fut création d’un espace sacré. La seconde fut le pas en avant, l’appropriation de cet espace sacré, son INCARNATION. C’est le corps créé, sans subterfuge, sans possibilité de créer lui-même, de repousser le problème de la matière. C’est le corps subi comme inévitable, douloureux par excès de vie. Comme un gland gonflé de sang. Remarque: le rôle du son dans L’homme rouge est important. L’image étant en quelque sorte l’illustration d’un cri, j’ai supprimé le son pour éviter une surenchère expressionniste (jugeant que l’image en elle même était suffisamment éloquente). Remarquons que l’action a eu lieu deux fois, la première ayant raté à cause de problèmes techniques. Cependant, en tant qu’expérience vécue, aussi bien pour moi que pour les quelques personnes présentes, elle fut réellement L’homme rouge. Le «produit» final correspond à la deuxième tentative. Elle est incontestablement meilleure car j’ai évolué au vu du premier essai dans le sens de l’image vidéo. Dans le premier essai, la violence est bien supérieure et cependant moins visible. Il semble qu’elle n’arrive pas à s’extérioriser. Les gestes sont plus hachés. L’énergie passe presque totalement dans les cris et la bande son est bien plus intéressante. Cette dépense d’énergie accumulée pendant près de six mois ne pouvait se rattraper en quelques jours. Je notais le phénomène avec intérêt, me confirmant la non-dépendance du produit et du vécu. Dans ce cas, au moins, les deux existent réellement. T.C (1980)
Le chien et l’ibis / texte catalogue biennale de Paris 1980
Il n’est donc pas question de dualisme proprement dit ici. Ce ne sont pas deux principes distincts et irréductibles qui s’affrontent, mais le même sous plusieurs aspects; une sorte d’éclatement de la raison dans ses moindres ramifications. Le stylo que j’ai dans les mains à l’instant peut alors contenir plus de secrets que le monde entier. « Ce qui caractérise les choses est qu’elles n’ont absolument pas de lois, et que mon arbitraire propre y règne, qui en fit des choses et qui va les anéantir.» (Antonin Artaud) C’est que je suis mille et à la fois je suis un, et je le nie. Le je est alors éclaté, et n’a plus pour vivre que ce double mouvement de déstructuration et de restructuration, chacun essayant d’être l’absolu. C’est là peut-être que se tiennent les limites de l’être; angoisse et détachement y prennent place tour à tour, nouant à chaque fois un peu plus la trame où la pensée s’englue, où elle crie de l’intérieur qu’elle se nie, qu’elle n’existe plus... C’est de l’étreinte foudroyante de l’être et du néant qu’il a engendré que naît le corps, relançant de nouveau à l’infini le problème de l’existence devant Dieu, cet «état limite de toute conscience, qui est la conscience se saisissant elle-même, sans le secours d’une individualité (...)» comme le définit Roger Gilbert-Leconte. C’est de cette mise en présence de Dieu et du Corps que naît le sacré. C’est que seul alors le corps peut exprimer l’angoisse ou l’extase que l’esprit a atteint en se mutilant. C’est le rituel de célébration du non-Dieu, suite de gestes dans l’espace, langage de signes remplaçant le langage parlé, sorte d’incarnation de la parole sacrée. On pourrait parler des dieux, en opposition au Dieu. Ces dieux qui n’étaient en fait, comme le dit Gilbert-Leconte dans Le grand Jeu n°4, «que des états de l’homme qui devenait ces dieux lorsqu’il entrait dans ces états.» On rejoint là certainement les rituels magiques des civilisations primitives, vies parallèles à la quotidienneté, qui retraçaient les grands évènements des cosmogonies. On pensera certainement à l’Egypte antique? Les masques d’animaux, chien et ibis, Anubis et Thot, figures mythiques du polythéisme égyptien. S’il est vrai que le contenu symbolique de ces deux héros psychopompes se trouvent avoir une résonnance dans le travail réalisé, c’est ici sans esprit d’anecdote. C’est cependant bien de symbolisme animalier dont il s’agit. De monstres tels que les craignait l’Eglise comme «chaos constitué par le démembrement des êtres organisés par Dieu», de monstres comme dans la préhistoire déjà, des représentations à tête animale ou sans tête, de monstres comme dans l’art byzantin un saint Christophe cinocéphale. L’utilisation du symbolisme animalier renoue avec une tradition primitive du rituel. Sans doute est-il encore en rapport avec l’interdit devant la mort et son complémentaire l’interdit sur le sexe. Pas de psychologie, pas d’anecdote, pas de spontanéité, pas de danse: un corps en signe et sa puissance directe jouant un cérémoniel minutieusement étudié, patiemment construit par toutes les fibres de l’esprit, esprit guidé en cela par «l’intuition», sorte d’avant-garde de l’être qui appréhende en un éclair ce qui se diffusera ensuite en une multiplicité de rapports entre le langage et l’action, la mémoire et la création. L’utilisation des masques fait disparaître l’identité des acteurs, soulignant au contraire la présence des corps. L’acteur ne devient pas corps sans tête, mais corps portant le symbole de la négation de l’esprit.
T.C (1980)
Pièce blanche
Accouchement
Pièce grise
le chien et l’ibis